Dans la majorité des organisations, l’usage de l’intelligence artificielle générative précède largement sa gouvernance. Selon une enquête mondiale menée par McKinsey en 2024, 90 % des salariés interrogés déclaraient déjà utiliser des outils d’IA dans leur travail, dont 21 % de manière intensive. Pourtant, seuls 13 % considéraient leur entreprise comme un précurseur dans ce domaine. Ce décalage, loin d’être inédit, s’inscrit dans une longue série d’innovations technologiques portées d’abord par les usages individuels avant d’être encadrées au niveau institutionnel.
On a vu les mêmes résistances avec les plateformes collaboratives, les réseaux sociaux professionnels ou les applications mobiles. Ce qui change avec l’IA, c’est l’accélération. Le laps de temps entre l’émergence d’un avantage compétitif et sa banalisation est désormais réduit à quelques mois. Les entreprises qui attendent trop risquent d’être dépassées non seulement par leurs concurrents, mais par leurs propres collaborateurs.
Du jardinage stratégique plutôt que du pilotage rigide
L’un des biais les plus répandus dans les organisations consiste à planifier de manière top-down l’adoption des technologies émergentes. Ce que certains appellent la « posture du menuisier » : découper, mesurer, assembler. Cette logique peut rassurer, mais elle est inadaptée à un environnement aussi mouvant que celui de l’IA. À l’inverse, une posture de « jardinier » – inspirée des travaux de la psychologue Alison Gopnik – consiste à observer les signaux faibles, repérer les expérimentations organiques, et favoriser leur croissance.
Certaines entreprises l’ont compris. En Asie, un groupe financier a vu émerger spontanément des usages d’IA dans ses équipes de développement. Plutôt que de les restreindre, les dirigeants ont soutenu l’initiative en créant une couche de données commune. Résultat : les temps de développement ont été divisés par deux. D’autres exemples abondent : des équipes relation client qui conçoivent des réponses automatisées via des assistants IA ; des fonctions support qui accélèrent la rédaction de documents ou l’analyse de données. Le rôle du manager n’est plus de tracer une route unique, mais d’identifier les sentiers prometteurs pour les transformer en autoroutes.
Changer les comportements : miser sur la reconnaissance plutôt que sur le contrôle
Mais l’adoption ne se décrète pas. Elle se stimule. Et la résistance au changement est souvent concentrée au sein du middle management : ces collaborateurs expérimentés, peu enclins à bouleverser des méthodes qui ont fait leurs preuves, surtout quand la charge de travail est déjà élevée. Pour déclencher une dynamique collective, les incitations doivent aller au-delà des bonus classiques.
Les organisations les plus agiles récompensent non pas l’usage en soi, mais la capacité à apprendre, à partager et à embarquer les autres. Des concours internes d’innovation, des journées dédiées à l’exploration, des hackathons transversaux, ou encore des temps de restitution collective sur les projets d’IA permettent de valoriser les parcours, et non seulement les résultats. La reconnaissance sociale – notamment quand elle émane de leaders respectés qui assument leurs tâtonnements – joue souvent un rôle plus décisif que les primes.
Chez certains grands groupes, l’innovation est ritualisée. Des journées libres sont consacrées à l’expérimentation, sans attente immédiate de rentabilité. L’objectif : détecter les idées décalées, non encore cartographiées dans les feuilles de route stratégiques, mais qui pourraient reconfigurer les priorités à moyen terme.
Expérimenter mieux, pas plus
L’expérimentation est au cœur de toute dynamique d’adoption. Mais encore faut-il en maîtriser les règles. Beaucoup d’initiatives échouent parce qu’elles sont trop floues, trop ambitieuses ou mal mesurées. Les entreprises les plus avancées reprennent les principes des tests A/B : hypothèses claires, échantillons réduits, protocoles rigoureux, et surtout, apprentissage systématique.
Il ne s’agit pas de multiplier les pilotes pour cocher des cases, mais de concevoir des expériences utiles. Mieux vaut tester une idée sur dix personnes pendant deux semaines avec des critères précis que de mobiliser un service entier sur un projet vague. L’essentiel est de comprendre pourquoi une solution fonctionne – ou échoue. Ce sont ces enseignements qui nourrissent l’intelligence collective.
L’exemple d’Amazon est parlant. Prime Video, dans ses débuts, ne suscitait qu’un intérêt modéré. Plutôt que d’abandonner, les équipes ont cherché à comprendre. L’analyse a montré que les utilisateurs ne percevaient pas la valeur du service isolément. En l’intégrant dans l’offre Prime globale et en investissant dans des contenus exclusifs, Amazon a redéfini la proposition de valeur, transformant un semi-échec en levier d’abonnement majeur.
Distinguer l’exploration de l’innovation à fort impact
Un piège fréquent dans les cultures d’innovation est celui de la célébration systématique. Tout projet IA devient un succès dès lors qu’il existe. Cette généralisation de l’enthousiasme finit par brouiller les repères. L’impact réel se mesure rarement à l’aune du buzz ou des effets d’annonce. C’est en exigeant de la rigueur dans l’évaluation que les organisations peuvent distinguer ce qui mérite d’être amplifié de ce qui doit être abandonné.
Certaines entreprises instaurent des critères stricts : un projet IA doit démontrer un gain concret en matière de satisfaction client, de réduction des coûts ou d’augmentation des revenus pour être soutenu à l’échelle. D’autres posent une condition budgétaire : un projet sponsorisé doit s’inscrire dans le plan de dépenses de l’année suivante. Cette exigence contraint les équipes à penser l’IA comme un levier stratégique, et non comme un gadget technique.
Changer la manière dont on parle des projets est aussi un levier puissant. Plutôt que de demander « Où en est votre expérimentation IA ? », il est plus pertinent de poser la question « Qu’avez-vous appris que vous ne saviez pas avant ? ». Ce glissement sémantique transforme le pilotage de l’innovation en processus d’apprentissage collectif.
L’avantage cumulatif des organisations apprenantes
Les organisations qui combinent ces pratiques – observation des usages émergents, incitations ciblées, expérimentation rigoureuse et évaluation exigeante – ne se contentent pas d’adopter l’IA plus vite. Elles développent un avantage cumulatif. Chaque essai réussi renforce la confiance interne. Chaque erreur documentée évite aux autres de la reproduire. Chaque initiative valorisée donne envie d’oser à ceux qui hésitaient encore.
Dans un écosystème où les règles du jeu sont en perpétuelle redéfinition, ces entreprises se dotent d’une capacité stratégique rare : apprendre plus vite que les autres. Ce n’est pas tant l’IA en elle-même qui crée l’avantage concurrentiel, mais la manière dont une organisation sait en tirer parti de manière progressive, pragmatique et collective.
Ceux qui s’en sortiront ne seront pas les plus puissants, mais les plus agiles. Les leaders jardiniers, capables de reconnaître les graines de transformation, d’arroser sans étouffer, et de tailler au bon moment pour faire fleurir l’essentiel.

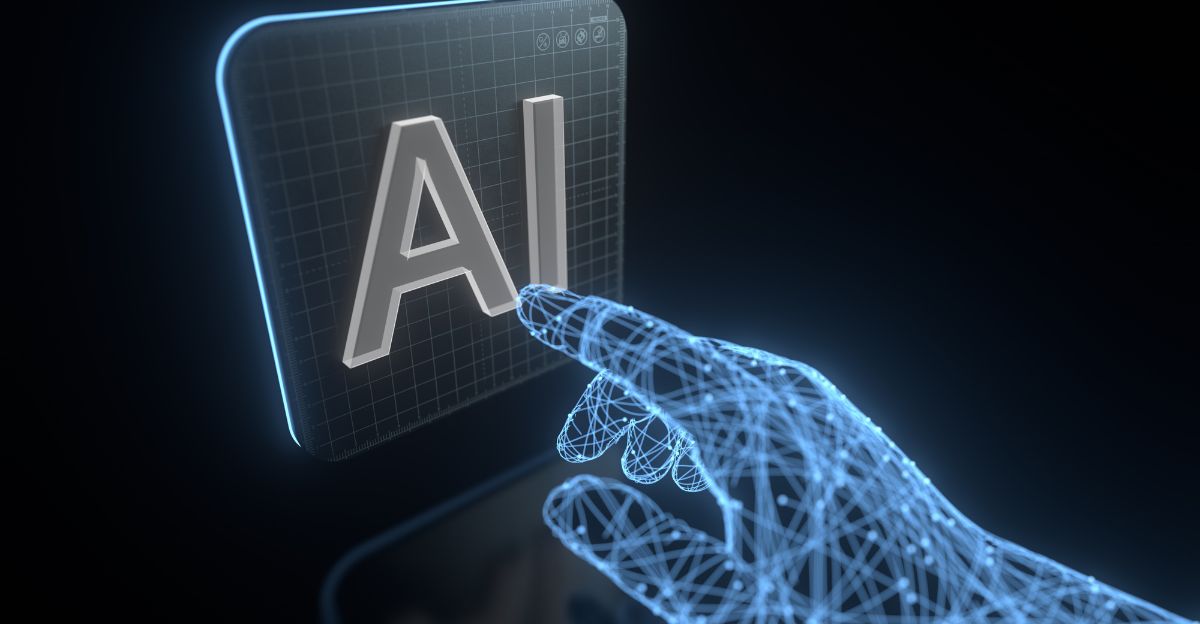






![[INTERVIEW] Stage PFE : piloter la pyramide de talents chez Deloitte Maroc — Interview avec Mélanie BENALI et Hicham OUAZI l DRH.ma](https://drh-ma.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/11/19103455/Interview-avec-Me%CC%81lanie-BENALI-et-Hicham-OUAZI.jpg)


