Le recours massif à l’intelligence artificielle générative dans les processus de travail et de formation transforme en profondeur notre rapport à la connaissance. Des outils comme ChatGPT sont plébiscités pour leur efficacité immédiate : ils produisent des contenus cohérents, répondent vite, et offrent une aide précieuse à des collaborateurs pressés ou peu à l’aise avec l’écriture. Mais à quel prix ? Cette question, longtemps restée théorique, trouve un début de réponse dans une étude rigoureuse conduite par le MIT Media Lab. L’objectif : mesurer l’impact cognitif réel de l’usage d’un LLM (Large Language Model) sur une tâche exigeante comme la rédaction d’un essai.
Un protocole expérimental inédit pour tester l’effet de ChatGPT sur le cerveau
L’étude, intitulée Your Brain on ChatGPT, a mobilisé 54 participants répartis en trois groupes : un premier utilisant uniquement ChatGPT (groupe LLM), un second autorisé à recourir à un moteur de recherche classique, et un troisième n’utilisant que leur cerveau, sans aide externe. Chaque participant devait rédiger des essais à partir de sujets issus du test SAT, sur plusieurs sessions, sous EEG (électroencéphalogramme) pour enregistrer l’activité cérébrale, avec analyse linguistique des textes, évaluation par des enseignants et entretiens individuels.
L’expérience s’est déroulée sur quatre mois. Lors de la quatrième session, les rôles ont été inversés : les participants du groupe LLM ont dû rédiger sans aide, tandis que ceux du groupe “cerveau seul” ont utilisé ChatGPT. Ce croisement a permis de tester les effets différés d’une exposition prolongée à l’IA.
Le résultat est frappant : les individus ayant régulièrement utilisé ChatGPT présentaient une activité cérébrale réduite, notamment dans les zones associées à la mémoire, à l’attention et à l’intégration visuelle. Leurs productions étaient plus homogènes, moins riches en entités nommées (noms propres, dates, lieux), et leur capacité à se souvenir de leur propre texte était largement inférieure à celle des autres groupes.
Cognition affaiblie, mémoire en berne, appropriation limitée
Dès la première session, les chercheurs constatent une différence nette entre les groupes. Dans le groupe LLM, 83 % des participants sont incapables de citer une seule phrase de leur essai sans le relire, contre seulement 11 % dans les groupes “recherche” et “cerveau seul”. En termes de citation exacte, aucun des utilisateurs de ChatGPT ne parvient à restituer correctement une phrase, tandis que les deux autres groupes atteignent plus de 85 % de réussite.
Cette difficulté de restitution s’accompagne d’un sentiment d’appropriation faible. Si 16 participants sur 18 dans le groupe “cerveau seul” estiment être pleinement auteurs de leur texte, ils ne sont que 9 dans le groupe LLM, et plusieurs expriment même un désengagement complet : « Je ne considère pas que c’est mon essai », déclare l’un d’eux. D’autres admettent avoir simplement copié-collé le contenu généré par l’IA, sans réelle relecture ni édition.
La perception de l’outil varie elle aussi fortement. Certains voient dans ChatGPT un assistant utile pour la formulation ou la grammaire, mais dénoncent des réponses trop formatées, parfois robotiques, et rarement personnalisées. D’autres, plus critiques, estiment qu’utiliser l’IA sur ce type de tâche est contre-productif : « Je préfère lire des articles d’opinion sur Internet que de demander à ChatGPT », souligne une participante.
L’éclairage des neurosciences : moins d’effort, moins d’activité
C’est dans l’analyse EEG que les écarts deviennent les plus préoccupants. L’activité neuronale est significativement réduite chez les utilisateurs de ChatGPT, notamment dans les bandes alpha et bêta associées à l’attention, à la mémoire de travail et à la planification. Plus le soutien numérique est fort, plus les réseaux neuronaux engagés sont limités.
Dans les sessions croisées, les effets se prolongent. Les participants du groupe LLM, appelés à écrire sans aide pour la première fois (session 4), conservent une activité cérébrale plus basse que leurs homologues, avec des difficultés notables à se souvenir de leurs essais précédents. À l’inverse, ceux ayant commencé sans IA et passant ensuite à ChatGPT manifestent un regain de mémoire, tout en gardant une capacité de structuration personnelle.
L’analyse des essais produits confirme cette tendance : les textes du groupe LLM sont plus courts, plus homogènes, avec un recours important à des expressions génériques, peu d’originalité lexicale, et une structure répétitive. Ceux issus du groupe “cerveau seul” sont plus diversifiés, plus personnalisés, et souvent plus convaincants sur le plan argumentatif.
Apprendre sans effort : une fausse promesse qui affaiblit les compétences
L’un des enseignements majeurs de cette étude est la notion de « dette cognitive ». En déléguant à l’IA les fonctions de mémoire, de raisonnement et de formulation, l’utilisateur économise de l’énergie sur le court terme… mais perd en capacité d’apprentissage. Il n’assimile plus, ne retient plus, et développe une forme de paresse métacognitive, comme le formulent les auteurs. Ce mécanisme, déjà identifié dans les travaux sur les moteurs de recherche (le fameux « effet Google », où l’on retient l’endroit où trouver l’information plutôt que l’information elle-même), prend une ampleur nouvelle avec les LLM.
Contrairement à une recherche active qui mobilise la curiosité, l’évaluation critique et la synthèse, l’interaction avec ChatGPT produit une réponse unique, directement consommable. Ce modèle linéaire, sans confrontation de sources, tend à appauvrir la réflexion et à enfermer l’utilisateur dans un cadre argumentatif figé. À long terme, cela affecte non seulement la mémoire mais aussi la capacité à structurer une pensée autonome.
Des implications concrètes pour les responsables RH et formation
Ces résultats doivent alerter les DRH, formateurs et responsables du développement des compétences. Si les outils d’IA générative peuvent faciliter la rédaction ou accélérer la production de documents, ils ne remplacent pas le processus d’apprentissage. Leur usage systématique, non encadré, peut même être contre-productif, en diminuant l’engagement cognitif des collaborateurs.
Faut-il alors interdire ChatGPT ? Non. L’enjeu est de concevoir des dispositifs pédagogiques qui articulent intelligemment assistance technologique et effort intellectuel. L’IA peut être un levier de stimulation, à condition de ne pas devenir un substitut à la réflexion. Cela suppose de former les collaborateurs à un usage critique et stratégique de ces outils : reformuler, comparer, argumenter, contredire l’IA si nécessaire.
De même, dans les dispositifs de e-learning ou de microlearning boostés à l’IA, il est crucial de maintenir un niveau élevé d’interaction humaine, d’évaluation formative, et de feedback personnalisé. Le développement des compétences ne peut reposer uniquement sur l’automatisation des contenus.
Ce que révèle l’étude du MIT, c’est que l’usage d’un outil comme ChatGPT, aussi impressionnant soit-il, n’est pas neutre. Il modifie nos habitudes cognitives, transforme notre rapport à l’écriture, et influence notre capacité à apprendre. Pour les entreprises qui investissent dans des stratégies de formation intégrant l’IA, il est essentiel de ne pas confondre aide et délégation totale.
Former demain, ce n’est pas seulement digitaliser l’apprentissage, c’est garantir que les collaborateurs restent les véritables acteurs de leur montée en compétence. Et cela, aucun algorithme ne peut le faire à leur place.
Consultez l’étude complète ci-après : cliquer ici

![[ÉTUDE] IA Générative et Apprentissage : ce que révèle le MIT sur les effets cognitifs de ChatGPT l DRH.ma](https://drh-ma.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/07/16154834/IA-Generative-et-Apprentissage-.jpg)
![[ETUDE] Croissance économique et emploi : pourquoi le Maroc peine à transformer sa dynamique en opportunités durables
l DRH.ma](https://drh-ma.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/10/03180451/ETUDE-Croissance-economique-et-emploi-pourquoi-le-Maroc-peine-a-transformer-sa-dynamique-en-opportunites-durables%E2%80%A8.jpg)
![[ETUDE] Chief People Officers Outlook 2025 : les DRH au cœur des transformations du travail l DRH.ma](https://drh-ma.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/09/14220404/ETUDE-Chief-People-Officers-Outlook-2025.jpg)

![[ÉTUDE] Comment les organisations peuvent tirer profit de l’IA générative : recommandations clés pour les leaders RH](https://drh-ma.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/06/17061518/IA-generative-1024x532.jpg)
![[RAPPORT] Vers une autonomisation économique des femmes au Maroc](https://drh-ma.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/06/17054017/autonomisation-e%CC%81conomique-des-femmes-au-Maroc.jpg)
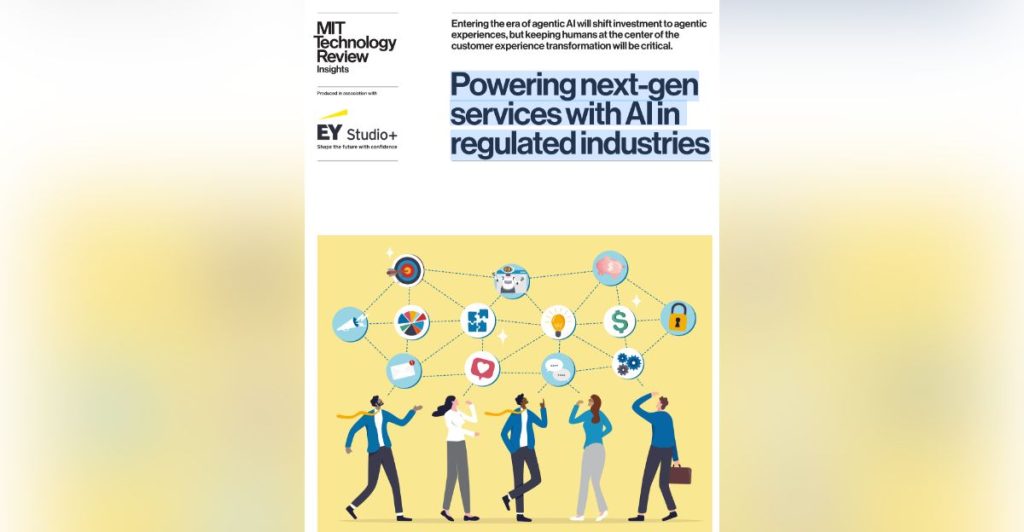
![[INTERVIEW] Stage PFE : piloter la pyramide de talents chez Deloitte Maroc — Interview avec Mélanie BENALI et Hicham OUAZI l DRH.ma](https://drh-ma.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/11/19103455/Interview-avec-Me%CC%81lanie-BENALI-et-Hicham-OUAZI.jpg)



