La scène est désormais familière : un collaborateur informe son employeur de son absence par un message WhatsApp, joignant en pièce jointe un certificat médical. Ce geste, rapide et pratique, est devenu courant dans de nombreuses entreprises marocaines. Mais ce qui semblait n’être qu’une formalité peut, en cas de litige, basculer en enjeu juridique majeur. C’est ce que vient d’illustrer une décision rendue fin juin 2025 par la Cour d’appel de Casablanca. Elle infirme un premier jugement qui avait accordé à une salariée plus de 222 000 dirhams d’indemnités, considérant que la notification par WhatsApp n’avait pas de valeur juridique au regard des procédures internes de l’entreprise.
Tout commence lorsqu’une employée, malade, adresse à son employeur un certificat médical via WhatsApp. Estimant que ce moyen de communication est largement utilisé dans l’entreprise, elle considère avoir rempli ses obligations. L’entreprise, de son côté, estime que seul l’e-mail professionnel est reconnu pour les notifications officielles. S’ensuit un refus d’accès au poste de travail, une tentative de conciliation auprès de l’inspection du travail, puis un contentieux judiciaire.
En première instance, le tribunal tranche en faveur de la salariée. L’entreprise est condamnée à lui verser une somme de plus de 222 000 dirhams pour licenciement abusif, dommages-intérêts, et autres indemnités. Mais cette décision sera cassée par la Cour d’appel de Casablanca, qui considère que l’usage de WhatsApp, en l’absence de reconnaissance formelle dans les procédures de l’entreprise, ne peut pas être retenu comme canal valide.
Ce jugement replace la question du formalisme au cœur des relations de travail. Même si un message est lu, il n’a pas de valeur probante s’il ne s’inscrit pas dans un cadre formalisé. Les directions RH sont donc invitées à réfléchir à la reconnaissance explicite des outils numériques qu’elles tolèrent ou utilisent dans leurs échanges quotidiens. Car le flou entre pratique informelle et cadre juridique peut coûter cher.
Quand la règle interne l’emporte sur l’usage répété
En statuant sur ce dossier, la Cour d’appel de Casablanca rappelle un principe fondamental : dans les rapports de travail, le respect du formalisme est essentiel. Selon les juges, le certificat médical transmis via WhatsApp n’est pas recevable, car ce canal n’avait jamais été officiellement reconnu dans les procédures internes de l’entreprise. Le message, bien que reçu et lu, n’a pas été jugé probant. Résultat : le licenciement a été validé, et la demande d’indemnisation rejetée.
Ce positionnement tranche avec une jurisprudence récente. En janvier 2024, la Cour de cassation avait pourtant reconnu la validité d’une notification via WhatsApp dans le cadre d’un usage établi. Cette décision soulignait l’importance d’adapter l’interprétation du droit aux pratiques numériques, en tenant compte de la réalité des échanges entre employeur et salarié.
La divergence entre les deux arrêts ne tient pas tant au canal utilisé qu’à son intégration – ou non – dans les usages formalisés. En 2024, WhatsApp faisait partie des pratiques tolérées et reconnues. En 2025, la Cour d’appel relève l’absence de formalisation dans le règlement intérieur, ce qui suffit à rendre la communication inopérante sur le plan juridique. Le contraste met en lumière une faille dans la gestion RH : l’acceptation tacite ne vaut pas validation formelle.
Les DRH doivent donc tirer une leçon claire de cette affaire : l’habitude ne constitue pas une preuve. Même si les collaborateurs et les managers échangent régulièrement par messagerie instantanée, cela ne remplace pas une procédure écrite. La sécurité juridique repose moins sur ce que les équipes font au quotidien que sur ce que l’entreprise encadre officiellement. Sans cela, les risques d’incompréhensions ou de litiges augmentent.
Cette décision remet donc la hiérarchie des normes à sa place dans l’univers numérique du travail. Le canal de communication doit être expressément autorisé, reconnu et intégré dans les documents de référence de l’entreprise pour produire un effet juridique. À défaut, il redevient un simple usage informel, sans portée.
L’encadrement juridique des outils numériques : un impératif RH
Pour les professionnels RH, cette affaire agit comme un révélateur. Elle met en lumière les failles potentielles liées à l’usage non encadré des outils numériques dans les processus de gestion RH. Le cas jugé à Casablanca rappelle que le droit du travail, s’il s’ouvre progressivement aux nouveaux usages, reste fondamentalement attaché à la formalisation des procédures.
Première leçon : les règlements internes doivent clairement énoncer les canaux valides pour notifier une absence, un arrêt maladie ou une demande de congé. Ce qui n’est pas écrit n’existe pas juridiquement. Il ne suffit pas qu’un outil soit utilisé, encore faut-il qu’il soit reconnu.
Deuxième enseignement : un canal comme WhatsApp peut être admis s’il est mentionné dans les documents de référence (charte informatique, guide RH, règlement intérieur) et si son usage est consensuel. Le fait que des managers échangent avec leurs équipes via cette application ne suffit pas à lui donner une valeur juridique.
Troisième point : il est indispensable de sensibiliser les collaborateurs. L’instantanéité ne dispense pas du respect des formes. Un message informel peut avoir des conséquences formelles. En cas de contentieux, seuls les échanges traçables, datés, et reconnus par l’entreprise pourront servir de preuve.
Enfin, ce jugement souligne l’importance d’un audit régulier des pratiques internes. Les entreprises doivent vérifier si les outils réellement utilisés sont bien ceux prévus par leurs textes. Trop souvent, l’écart entre la pratique et la norme ouvre des brèches juridiques. Fermer ces brèches ne passe pas par l’interdiction, mais par la clarification.
Mettre à jour les pratiques RH à l’heure du numérique
L’évolution rapide des outils de communication oblige les directions RH à adapter leurs politiques en continu. Les messageries instantanées, plateformes collaboratives, portails RH ou solutions de gestion des absences doivent être encadrés pour éviter tout flou juridique. Utiliser un outil ne suffit pas. Il faut en définir les modalités d’usage, les types de communication autorisés, et les responsabilités associées.
La démarche implique un travail conjoint entre les services RH, juridiques et informatiques. L’objectif n’est pas de freiner la digitalisation, mais de l’encadrer. Car ce qui protège l’entreprise, ce n’est pas la technologie, mais le cadre dans lequel elle est utilisée. Formaliser l’usage des outils numériques, c’est éviter des contentieux évitables et sécuriser les échanges.
Le jugement de Casablanca pose aussi la question d’un éventuel encadrement législatif. Faut-il aller vers une clarification des règles en matière de communication numérique dans les relations de travail ? Plusieurs pistes sont évoquées : liste des canaux reconnus, formats admis, délais à respecter. Sans un minimum de cadrage, chaque litige continuera d’être tranché au cas par cas, avec un risque d’insécurité juridique croissant.
Dans l’intervalle, les DRH peuvent déjà mettre en œuvre des mesures simples : mise à jour du règlement intérieur, formation des collaborateurs, documentation systématique des échanges clés, audit régulier des outils utilisés. Car au final, un message n’est jamais neutre. Il engage, parfois à tort, parfois à raison.
Pour les DRH marocains, cette affaire constitue une opportunité : celle de remettre à plat les règles, de renforcer la sécurité juridique, et de mieux articuler les pratiques numériques aux exigences du droit du travail. Entre souplesse technologique et rigueur juridique, il est temps de trouver un équilibre clair.

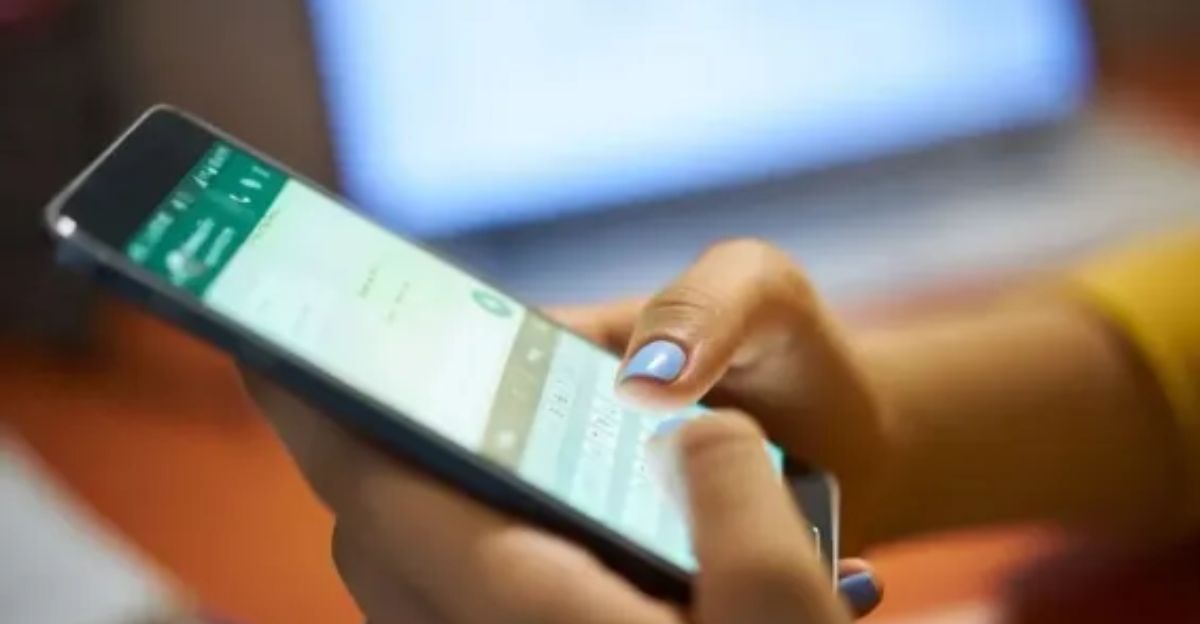






![[INTERVIEW] Stage PFE : piloter la pyramide de talents chez Deloitte Maroc — Interview avec Mélanie BENALI et Hicham OUAZI l DRH.ma](https://drh-ma.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/11/19103455/Interview-avec-Me%CC%81lanie-BENALI-et-Hicham-OUAZI.jpg)



