L’intelligence artificielle n’est plus une promesse futuriste. Dans les secteurs les plus encadrés — santé, banque, assurance — elle est déjà à l’œuvre. Et les directions des ressources humaines sont directement concernées. À l’intersection des usages clients et des attentes internes, elles doivent désormais intégrer l’IA comme un levier stratégique d’expérience collaborateur.
Le rapport de MIT Technology Review Insights, mené auprès de dirigeants de grandes entreprises réglementées, confirme cette tendance : l’IA est intégrée ou en cours d’intégration dans tous les services clients des répondants. Mais derrière cette adoption accélérée, ce sont les pratiques RH qui s’en trouvent reconfigurées. Du chatbot RH au coaching de carrière personnalisé, la frontière entre expérience client et expérience collaborateur devient de plus en plus perméable.
De la relation client à l’expérience collaborateur : l’IA RH s’installe
Les outils les plus déployés sont déjà bien connus : 72 % des entreprises sondées utilisent des chatbots conversationnels, 68 % des portails en libre-service, et 63 % des systèmes de recommandations personnalisées. Si leur usage est souvent centré sur le client, ces technologies trouvent des équivalents directs dans les services RH.
À titre d’exemple, les chatbots RH se banalisent pour répondre aux questions fréquentes sur la paie, les congés, ou les procédures internes. Les portails RH personnalisés permettent aux collaborateurs d’accéder à leurs données, de gérer leurs formations ou de simuler leur évolution professionnelle. Le tout, sans solliciter un interlocuteur humain.
Mais la révolution la plus profonde vient de l’IA dite « agentique ». Cette nouvelle génération d’intelligences artificielles n’exécute plus simplement des ordres : elle comprend le contexte, propose des solutions, et peut même accompagner des décisions complexes. Certaines entreprises l’utilisent déjà pour gérer la succession administrative après un décès, accompagner l’achat d’un logement ou consolider des dettes. Demain, ces agents pourraient assister les collaborateurs dans des problématiques internes : arbitrage de congés, mobilité, santé mentale, ou optimisation des droits sociaux.
Seule une minorité (25 %) a franchi le pas, mais la dynamique est enclenchée. Pour les DRH, l’enjeu est clair : anticiper cette montée en puissance pour que l’expérience collaborateur reste fluide, personnalisée… et humaine.
Réglementation et IA : une alliance inattendue
À rebours des idées reçues, la complexité réglementaire ne freine pas l’innovation. Elle l’encadre. L’étude révèle qu’un tiers des dirigeants considèrent que les règles en vigueur dans leur secteur accélèrent l’adoption de l’IA. Et pour cause : les entreprises réglementées ont déjà une culture de la conformité, des processus de validation stricts et une gouvernance structurée. Autant d’atouts pour déployer une IA responsable.
Sonny Shergill, vice-président digital chez AstraZeneca, résume cette dynamique : « La gestion de la réglementation peut devenir une superpuissance pour innover plus vite. » Ce constat est valable tant pour l’expérience client que pour l’expérience collaborateur.
Pour les DRH, c’est une opportunité à saisir : les comités de conformité peuvent devenir des partenaires de confiance pour encadrer l’expérimentation de nouvelles solutions IA internes. Loin d’être un frein, la réglementation offre un cadre rassurant pour tester des innovations RH à forte valeur ajoutée, en garantissant l’éthique et la sécurité des données.
La confiance, socle de toute adoption technologique
Si l’IA progresse vite, la confiance ne suit pas toujours au même rythme. C’est le principal frein identifié par les dirigeants interrogés : 57 % d’entre eux placent la protection des données en tête de leurs préoccupations. La facilité d’utilisation (46 %) et la transparence (41 %) complètent ce podium.
Les clients, quant à eux, restent sceptiques. Moins de la moitié des usagers des services financiers (42 %) et de santé (47 %) font confiance à leurs fournisseurs pour utiliser l’IA dans leur intérêt. Ce chiffre chute à 37 % lorsqu’il s’agit de remplacer un médecin par une IA.
Les attentes en matière de transparence sont élevées : pour que l’IA gagne la confiance des usagers, il faut informer sur la collecte des données (64 %), obtenir un consentement explicite (56 %) et communiquer sur les limites des capacités de l’IA (51 %). Ces exigences doivent s’appliquer également à l’interne.
C’est ici que le rôle des RH devient central. Il revient aux DRH de créer les conditions d’une adoption sereine de l’IA par les collaborateurs : expliquer les finalités, assurer la sécurité des données personnelles, instaurer un dialogue éthique. Cela suppose des campagnes de sensibilisation, des formations régulières et un accompagnement managérial adapté.
Les trois piliers d’une expérience collaborateur augmentée par l’IA
Le rapport identifie trois leviers essentiels pour réussir l’intégration de l’IA agentique dans les parcours internes :
- Transparence sur l’identité des agents : L’étude souligne que la plupart des utilisateurs ne souhaitent pas être trompés : ils veulent savoir s’ils interagissent avec un humain ou un système automatisé. Pour les collaborateurs, cette clarté est d’autant plus importante que les IA deviennent de plus en plus performantes dans l’imitation de comportements humains. L’interface RH doit afficher clairement qui ou quoi répond.
- Personnalisation des interactions : L’IA offre la possibilité d’adapter finement les parcours, en croisant données de compétences, souhaits de mobilité et besoins business. Un agent intelligent peut ainsi recommander un plan de formation, proposer une évolution de poste ou alerter sur un risque d’attrition. Cette personnalisation suppose toutefois une collecte massive de données internes — un processus à encadrer rigoureusement, notamment vis-à-vis du RGPD ou des chartes internes.
- Automatisation raisonnée : De nombreuses tâches RH peuvent être automatisées : onboarding, gestion des absences, rappels administratifs, diffusion de documents, suivi de la conformité. Mais l’automatisation ne doit jamais aboutir à la déshumanisation. Les fonctions à forte charge émotionnelle (retour d’arrêt, conflit, évaluation) doivent rester entre mains humaines. Pour les DRH, l’enjeu est de définir la frontière entre automatisation efficiente et relation humaine indispensable.
Le benchmark CRMArena-Pro : des leçons utiles pour les RH
Le rapport s’appuie sur une évaluation comparative de plusieurs agents conversationnels à base de LLM (Large Language Models), testés dans des situations réalistes de service client. Les résultats révèlent des performances hétérogènes : 58 % de succès en moyenne sur des tâches simples, mais seulement 35 % dans les interactions complexes.
La capacité à exécuter des workflows structurés est la plus maîtrisée. En revanche, la conscience des enjeux de confidentialité reste quasi inexistante. Aucun modèle n’intègre spontanément les bonnes pratiques de protection des données. Et lorsqu’on les ajoute manuellement, cela se fait au détriment des performances.
Cette réalité technique impose une vigilance accrue côté RH. L’IA ne peut pas encore gérer seule des enjeux sensibles liés à la vie privée des collaborateurs. Elle doit être encadrée, supervisée, et intégrée dans une logique de complémentarité homme-machine. Les compétences à développer dans les équipes vont dans ce sens : raisonnement critique, intelligence émotionnelle, capacité à collaborer avec l’IA, et maîtrise de l’éthique numérique.
L’IA n’est plus un projet d’avenir. C’est une technologie déjà à l’œuvre, qui redéfinit la façon dont les collaborateurs vivent l’entreprise. Dans les secteurs réglementés, cette mutation s’accompagne de contraintes… mais aussi de solides garanties. Aux DRH de transformer ces contraintes en opportunités. L’expérience collaborateur, demain, ne sera pas simplement augmentée par l’IA : elle sera co-construite avec elle.
Pour consulter le rapport complet de MIT Technology Review Insights 2024, cliquez ici.

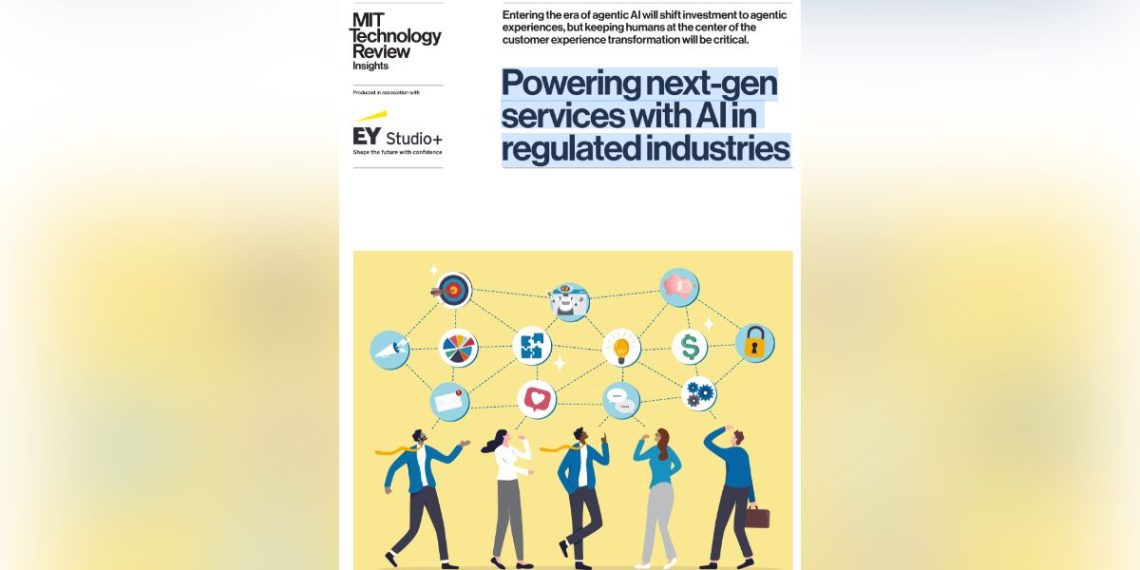
![[ETUDE] Croissance économique et emploi : pourquoi le Maroc peine à transformer sa dynamique en opportunités durables
l DRH.ma](https://drh-ma.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/10/03180451/ETUDE-Croissance-economique-et-emploi-pourquoi-le-Maroc-peine-a-transformer-sa-dynamique-en-opportunites-durables%E2%80%A8.jpg)
![[ETUDE] Chief People Officers Outlook 2025 : les DRH au cœur des transformations du travail l DRH.ma](https://drh-ma.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/09/14220404/ETUDE-Chief-People-Officers-Outlook-2025.jpg)

![[ÉTUDE] Comment les organisations peuvent tirer profit de l’IA générative : recommandations clés pour les leaders RH](https://drh-ma.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/06/17061518/IA-generative-1024x532.jpg)
![[RAPPORT] Vers une autonomisation économique des femmes au Maroc](https://drh-ma.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/06/17054017/autonomisation-e%CC%81conomique-des-femmes-au-Maroc.jpg)
![[RAPPORT]Les tendances RH 2025 : Comment l’IA et la réinvention des compétences transforment le Maroc](https://drh-ma.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/06/17051005/Tendances-RH-2025-Maroc-1024x532.jpg)
![[INTERVIEW] Stage PFE : piloter la pyramide de talents chez Deloitte Maroc — Interview avec Mélanie BENALI et Hicham OUAZI l DRH.ma](https://drh-ma.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/11/19103455/Interview-avec-Me%CC%81lanie-BENALI-et-Hicham-OUAZI.jpg)



